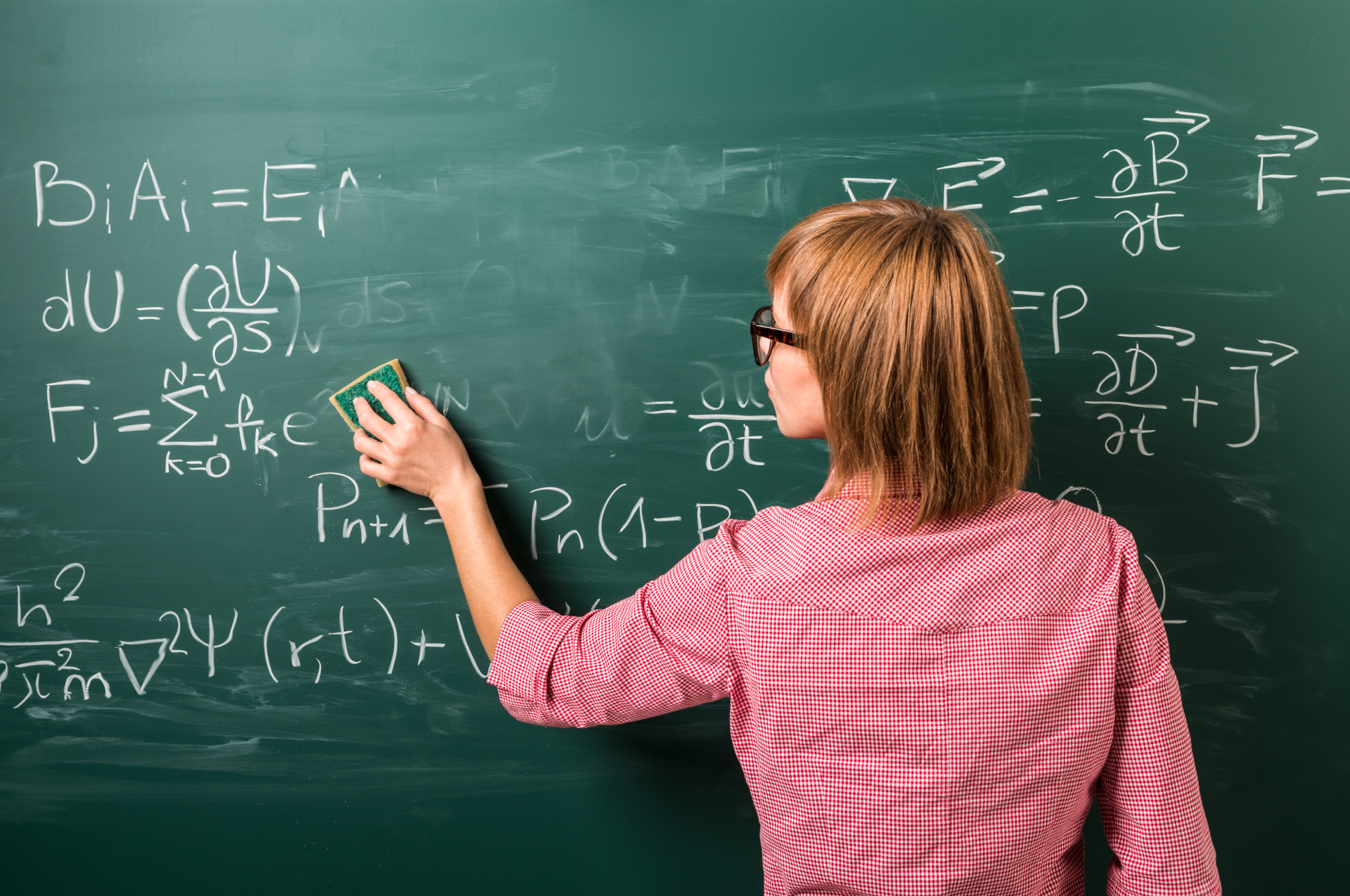Surtout ne dîtes pas "classement" ou "palmarès" des collèges et des lycées. La simple évocation de ces mots agace au plus haut point le ministère de l’Éducation nationale qui doit dévoiler aujourd’hui les nouveaux "Indicateurs de valeur ajoutée" 2023 de ces établissements du secondaire, publics et privés sous contrat. Hélas, il en va des lycées et des collèges comme des hôpitaux ou des restaurants étoilés : qui dit évaluation dit possibilité de classement et donc palmarès. Ce n’est bien sûr pas nouveau, le "palmarès" des lycées existe d’ailleurs depuis trois décennies, lorsque l’hebdomadaire L’Express en avait publié un, en 1993, dans un numéro spécial titré "Le classement secret du ministère". Un ministère alors occupé par François Bayrou, qui avait rallumé une guerre scolaire public-privé en voulant réformer la loi Falloux. En 1994, l’actuel maire de Pau avait rendu publiques les évaluations – qui n’avaient rien de "secret" – et déjà, à l’époque, derrière les chiffres se trouvait la rivalité public-privé.
Trente-et-un an plus tard, l’appréhension des indicateurs ministériels peut toujours se lire sous ce prisme. Les syndicats enseignants évoquent ainsi chaque année combien ces indicateurs servent, selon eux, à créer de la concurrence entre établissements et à établir artificiellement des hiérarchies entre lycées. Ils dénoncent les inégalités que provoquent les palmarès nés des indicateurs et notamment le plus connu, le taux de réussite au baccalauréat, pour lequel les établissements qui sélectionnent leurs élèves – très souvent des lycées privés – sont avantagés au détriment des lycées publics qui accueillent, eux, tous les profils d’élèves sans distinction. Les lycées privés peuvent ainsi se targuer de meilleurs résultats, attirant ainsi une population d’élèves déjà favorisée, dans un cercle vertueux qui ne fait qu’accroître les inégalités.
Pour autant, comme le recommande à la presse le ministère de l’Éducation nationale, il convient de regarder tous les indicateurs et pas seulement le taux de réussite au bac. Le taux d’accès au baccalauréat des élèves de seconde, de première ou de terminale, ou le calcul de valeur ajouté qui mesure les résultats obtenus et les résultats qui étaient espérés, compte tenu des caractéristiques scolaires et sociologiques des élèves, sont des données qui peuvent être utiles pour les chefs d’établissements comme pour les équipes pédagogiques.
Mais une forme d’incompréhension a fini par s’installer entre ministère et enseignants, particulièrement depuis 2017, avec la multiplication des évaluations, en nombre et en fréquence. Le premier ministre de l’Éducation nationale d’Emmanuel Macron, Jean-Michel Blanquer, avait fait du pilotage par l’évaluation son mantra et créé un Conseil d’évaluation de l’école à sa main. Cet effort de diagnostic censé anticiper les résultats des classements internationaux – où la France a clairement décroché, notamment en maths et en français – s’est heurté à des résistances du monde enseignant, qui dénonce des évaluations stigmatisantes et ne prenant pas assez en compte les besoins.
S’entendre sur le constat pour que l’école – et particulièrement l’école publique – puisse progresser semble pourtant indispensable. Mais pour cela il faut de la confiance. Entre la controversée réforme Blanquer du bac, la réforme à marche forcée du collège avec les groupes de niveaux ou le retour du redoublement que ne valide aucune étude, la confiance n’est pas là. Les évaluations, et leurs palmarès, ces miroirs déformants, constituent dès lors davantage un irritant qu’un moteur.