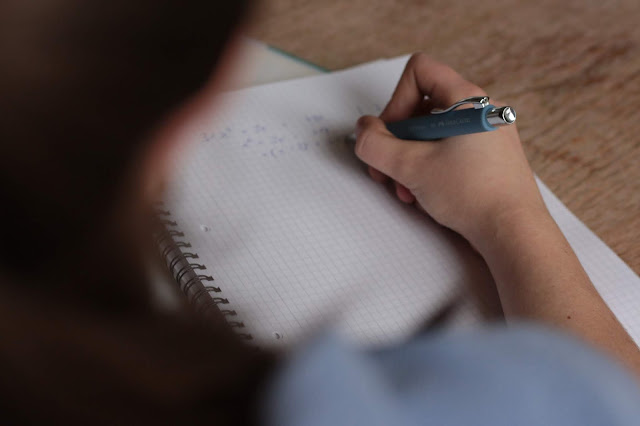C’est une petite musique qu’on commence à entendre et qui serait la reprise d’une autre jouée en 1968. Comme après le mois de mai de cette année-là, certains estiment que le bac 2020 serait un bac au rabais, un "bac donné" puisque le gouvernement a décidé, en raison de la crise sanitaire du coronavirus, d’annuler les épreuves écrites de l’emblématique examen centenaire pour les remplacer par le seul contrôle continu sur deux trimestres.
Il y a plus de cinquante ans, le bac 68 avait été passé en une journée, entièrement à l’oral. Depuis, l’idée simpliste du "bac donné" est restée des années dans l’inconscient collectif, au moins jusqu’à ce qu’en 2005, deux économistes, Eric Maurin et Sandra McNally, décident d’enquêter sur les bacheliers de cette année-là. Dans "Vive la Révolution ! Les bénéfices de long terme de Mai 68" (Ed. La République des idées), le duo s’est attelé à suivre le parcours des bacheliers de 1968 et en a conclu que "lorsque l’on suit ces "élus" dans le temps, on s’aperçoit que cette opportunité (de faire des études supérieures) s’est traduite, des années plus tard, par un surcroît de salaires et de réussite professionnelle par rapport aux étudiants qui, nés un an plus tôt ou plus tard, n’avaient pas eu la chance de se trouver au bon endroit du système éducatif au bon moment de son histoire". Autrement dit cet "accident" dans l’organisation du bac n’a en rien gêné l’avenir des bacheliers de 68. Voilà de quoi rassurer les lycéens d’aujourd’hui qui s’inquiètent de la valeur du diplôme qu’ils décrocheront dans quelques semaines.
En revanche, le bac 2020 privé des épreuves écrites terminales – qui constituent de fait le véritable rite de passage de l’examen – pose les mêmes questions que celles abordées lors de la présentation de la réforme du bac 2021 qui introduisait une part de contrôle continu : le poids des inégalités sociales. La continuité pédagogique mise en œuvre durant le confinement a d’ailleurs surligné ces inégalités entre élèves. L’environnement social, familial, culturel était déjà primordial pour un bac classique, avec toutefois la possibilité offerte aux lycéens de se surpasser dans les épreuves finales. Avec le contrôle continu – qui reste soumis à l’arbitraire – le sprint final est remplacé par un marathon dont on sait d’avance qu’il pourrait en laisser certains sur le chemin.
Dans le "monde d’après" que veut bâtir Emmanuel Macron, la prise en compte de cette réalité-là paraît, dès lors, primordiale si l’on veut maintenir le caractère universel du baccalauréat auquel les Français restent toujours très attachés, afin que chaque jeune, quel que soit son milieu social, quelles que soient ses capacités à l’entrée en seconde et quel que soit l’emplacement de son lycée en France, ait les mêmes chances de réussite.
(Editorial publié dans La Dépêche du Midi du mercredi 20 mai 2020)